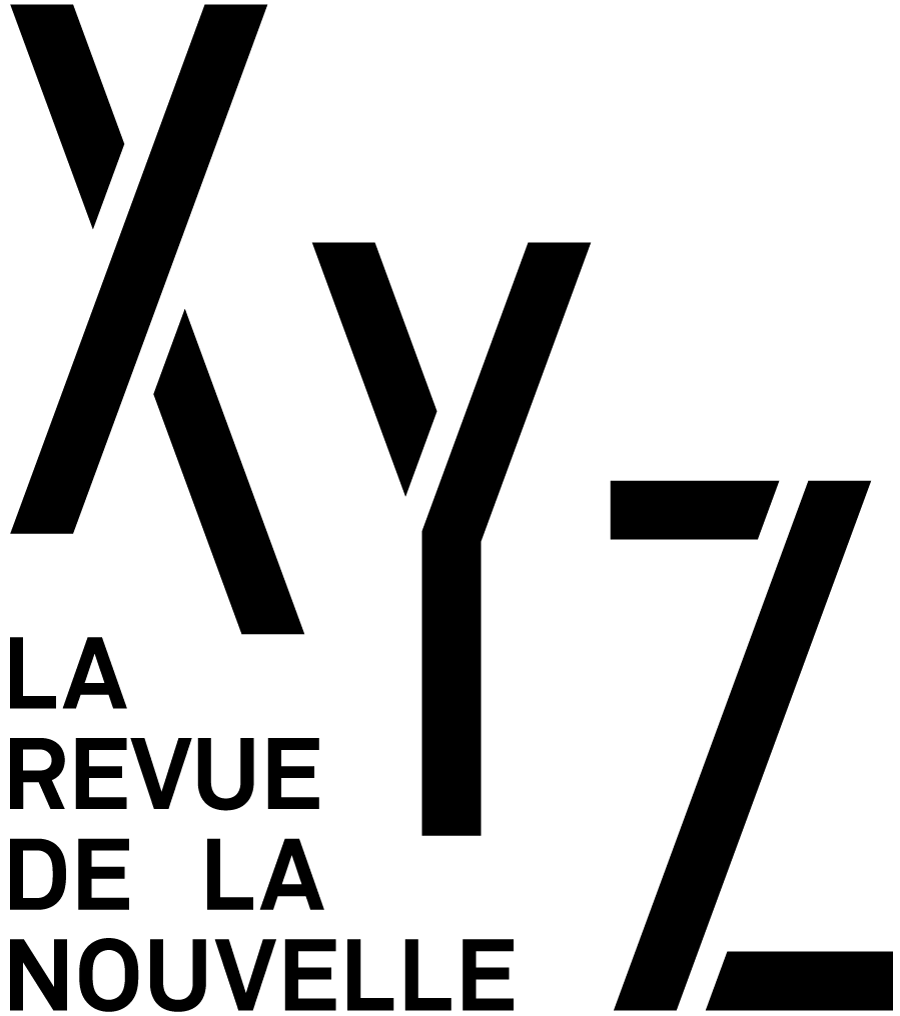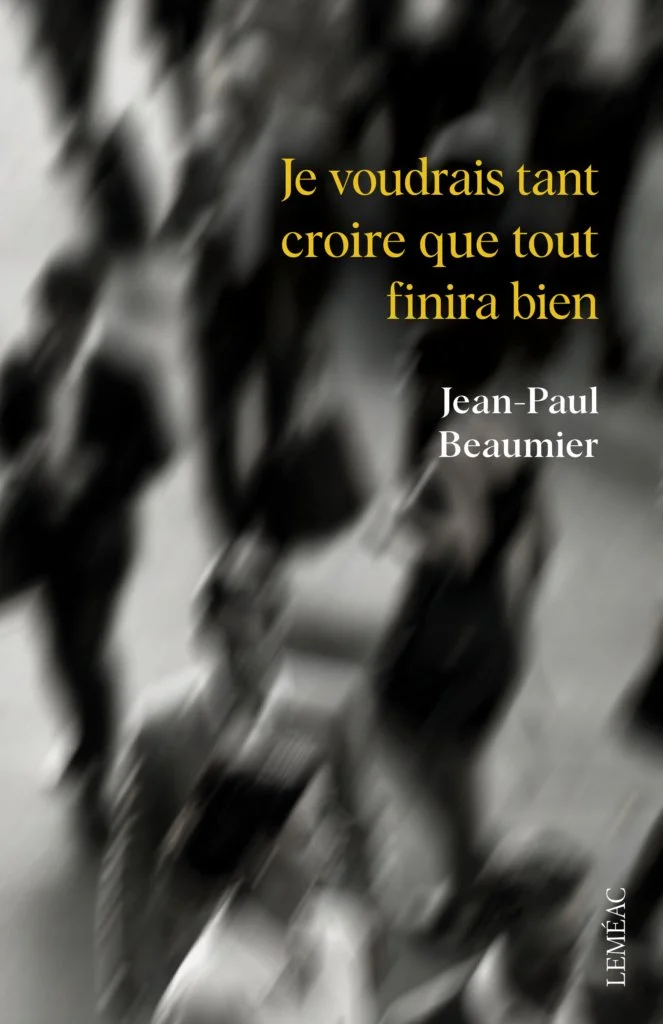Une ombre persistante
Jean-Paul Beaumier, Je voudrais tant croire que tout finira bien
Montréal, Leméac, 2025, 133 p.
À la lecture du titre du dernier recueil de Jean-Paul Beaumier, Je voudrais tant croire que tout finira bien, on devine à la fois un sentiment de désespoir et une volonté de croire, malgré tout, que la situation pourrait s’améliorer, que la vie continuera pour le mieux. Il existe en effet un peu des deux dans ce recueil où la maladie (le cancer joue un rôle important), la décrépitude et la mort sont largement présentes. Pourtant, on y respire également une forme de mélancolie qui empêche que l’abîme se referme complètement. Il y a parfois des passages inattendus, des rayons de lumière qui viennent colorer des paysages plutôt sombres. Cela tient pour beaucoup à l’écriture maîtrisée d’un écrivain d’expérience qui sait comment évoquer des moments de grâce aux instants les plus tragiques.
Il reste que ce recueil, largement hanté par la pandémie qui aura su traumatiser les populations au début de cette décennie, sait mettre en scène des moments d’angoisse. La nouvelle sans doute la plus saisissante de ce point de vue est d’ailleurs une de celles qui concernent le plus frontalement la pandémie. Dans un récit qu’on lit comme une sorte d’intensification du stress que plusieurs ont vécu à cette époque (récente, mais qui semble déjà loin), un couple âgé se rend dans un centre, heureux de pouvoir enfin se faire vacciner. Rapidement cependant, l’homme et la femme découvrent la dimension quasi carcérale de l’exercice. Les citoyens sont bousculés, on leur impose de se taire, des militaires sont présents pour faire respecter l’ordre. Puis la femme, en pleurs, apprend à son mari qu’on lui refuse le vaccin, et l’un et l’autre sont conduits dans un car bondé qui démarre rapidement. « Odette pleurait en silence. Je n’avais même pas mon cellulaire pour prévenir quelqu’un, mais prévenir qui? et de quoi? » (55) Voilà bien la chute la plus naturelle, pourrait-on dire, de cette histoire : le vide qui s’ouvre devant le couple est l’aboutissement angoissant de ce qui se déroule dans un système totalitaire; l’objectif est d’abord de faire en sorte que les individus perdent leurs repères.
S’il s’agit assurément de la nouvelle aux contours les plus sinistres, d’autres s’inscrivent dans une veine sombre d’où, comme je l’écrivais plus haut, la mélancolie n’est pourtant pas absente. Ainsi de la première nouvelle, « 1754 rue Notre-Dame », emblématique du recueil et qui l’ouvre de manière juste et sensible. Le narrateur raconte que sa mère très âgée, ayant vu une annonce pour une visite à cette adresse, voulait revoir la maison où lui et ses frères avaient grandi avant que leur père ne se décide à la vendre. La famille avait déménagé dans une maison à l’extérieur du centre-ville, et le père s’était converti à la permaculture, produisant quantité de légumes dans un magnifique potager. Mais cet homme était mort d’un infarctus foudroyant au milieu de ses plants de tomates – à la manière du parrain dans le film de Coppola, plaçant sur le même plan la mort d’un puissant et d’un individu de la classe moyenne, une manière de montrer que la mort frappe partout à l’identique. La mère du narrateur, revenue vivre en ville depuis, veut donc revoir cette maison de l’intérieur, même si elle a depuis le temps été transformée en simple maison de chambres. Elle en ressort défaite, épouvantée par l’état de dépérissement de ce qui avait un jour été son chez-soi. Mais n’est-ce pas également la condition de cette femme qui se retrouvera bientôt dans une résidence pour personnes âgées et qui ne l’a pas encore vraiment accepté? On a l’impression d’une douloureuse relation entre l’identité du sujet et son environnement immédiat qui relève en fait d’un passé révolu : ce qu’elle était à travers un territoire, son monde, n’est plus.
Le titre, en indiquant une adresse précise, semble ancrer la nouvelle au cœur du réalisme. Mais cette adresse est-elle réelle ou est-ce un lieu purement imaginaire? La question se pose dans la mesure où on a l’impression parfois d’un jeu de cache-cache d’une nouvelle à l’autre, comme s’il s’agissait de poursuivre la même histoire. Ainsi en est-il de « Boules chinoises », qui pourrait laisser croire que la femme de la première nouvelle est dorénavant installée dans sa maison de retraite. Mais non, puisque c’est elle qui semble alors s’occuper d’un jardin, et certains noms ne correspondent pas d’une nouvelle à l’autre. Peu importe : il s’agit surtout de montrer que des thèmes, des motifs se font écho d’une nouvelle à l’autre, rebondissent et viennent hanter les propos de différents narrateurs.
On pourra regretter de ce point de vue que certaines nouvelles soient un peu décalées par rapport à l’ensemble (par exemple « Faites demi-tour », un peu faible, « La Marocaine », néanmoins fort intéressante), faisant perdre au recueil une part de son homogénéité. On pourra à l’inverse trouver que ces « échappées » sont aussi le signe d’un recueil qui refuse de se voir corseté et qui s’ouvre à des voies diverses. Aux lecteurs et aux lectrices de décider.
Jean-François Chassay